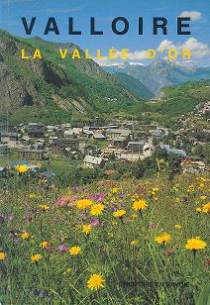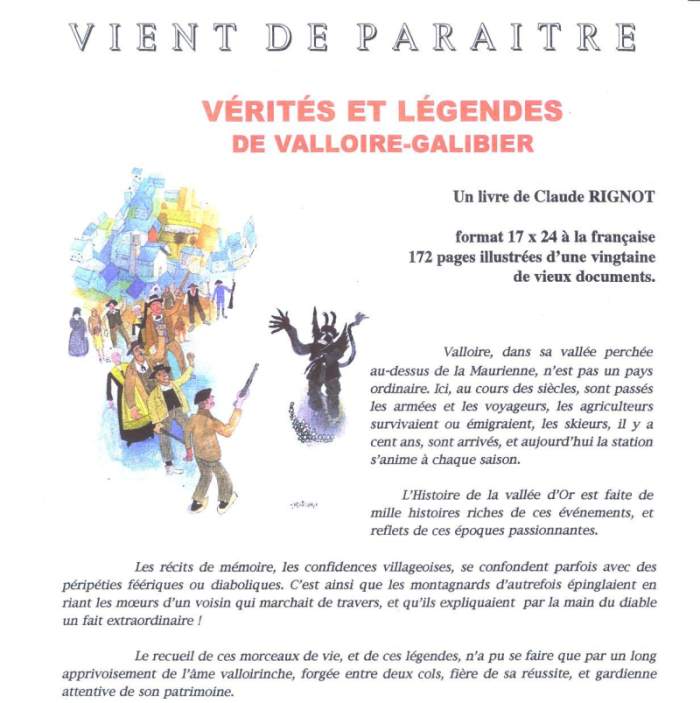|
1. Un jour, il y a très
longtemps ...
Notre
voyage commence au quaternaire. A cette époque, la vallée suspendue de Valloire
est occupée par un glacier, qui s'étend du Galibier à St Michel de Maurienne. Il
a d'ailleurs laissé des traces aujourd'hui, comme les roches dures de Point
Ravier et de St Pierre. Ce glacier amorce son retrait à la fin du Paléolithique,
vers 10000 avant JC. Les premières occupations humaines commencent vers 8000
avant JC, elles ne sont au début que temporaires, il s'agit de chasseurs
lors de la saison
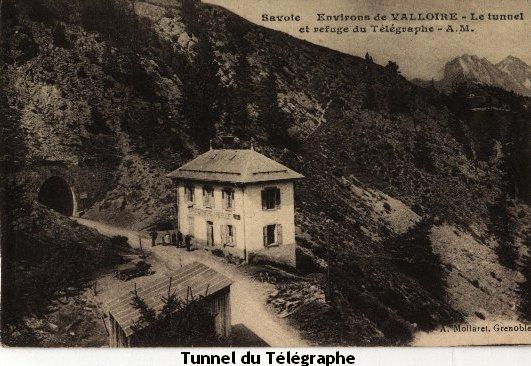 estivale. Puis les bergers de la Maurienne montent nourrir les
bêtes dans les pâturages de la Valloirette à la fin du printemps. C'est ainsi
que les premières habitations arrivent dans cette vallée, vers 2000 avant JC.
Les hommes découvrent alors d'autres possibilités : cette vallée est propice à
l'agriculture, et on y trouve beaucoup de bois et de minerais. A cause de
l'obstacle des eaux, la Maurienne va rester déserte encore longtemps. En fait,
les Alpes se sont d'abord peuplées par le haut. estivale. Puis les bergers de la Maurienne montent nourrir les
bêtes dans les pâturages de la Valloirette à la fin du printemps. C'est ainsi
que les premières habitations arrivent dans cette vallée, vers 2000 avant JC.
Les hommes découvrent alors d'autres possibilités : cette vallée est propice à
l'agriculture, et on y trouve beaucoup de bois et de minerais. A cause de
l'obstacle des eaux, la Maurienne va rester déserte encore longtemps. En fait,
les Alpes se sont d'abord peuplées par le haut.
Faisons
un grand saut dans le temps, durant lequel la population de Valloire n'a cessé
de s'accroître; en effet, après chaque épidémie, ou famine, la population
revenait de plus belle. La population était au moyen âge d'environ 2000
habitants, Valloire était une des principales communautés rurales de la Savoie.
Puis, nous nous retrouvons au 19e siècle. Valloire est depuis toujours un lieu
de passage, avec le col du Galibier, entre la France et la Savoie. Ce trajet est
rendu carrossable en 1872 avec la construction d'une route (de 1872 à 1877). A
l'époque, elle ne montait pas jusqu'à l'actuel col du Télégraphe: elle coupait
cette barre rocheuse à 1600 m d'altitude par un tunnel (l'entrée est encore
visible, en face de la maison, vers la fin de la montée). Voici une photo de ce
tunnel à l'époque, cliquez sur celle ci pour voir l'endroit actuellement. Cette route rejoignit
ensuite le col du Galibier en 1879, ou le tunnel fut percé en 1891 (puis refermé
en 1976, et réouvert en 2002).
Haut de page
Ý
|
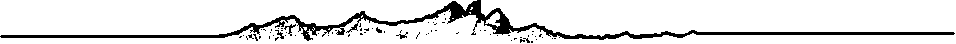
2.
L'époque des conflits
Le fort
du télégraphe est construit en 1890, ainsi que le camp des Rochilles et le
blockhaus du Galibier vers 1905 (photo ci contre),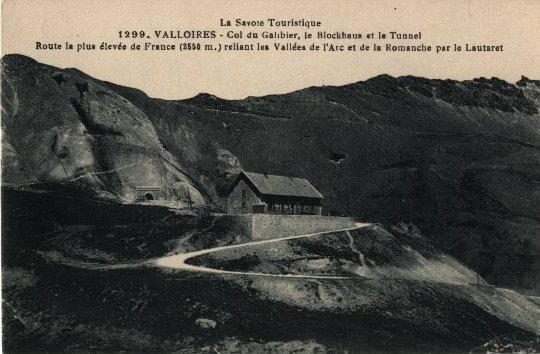 pour barrer la route de passage du Galibier, et
faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les
travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du
fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en
1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,
afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les
allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui
leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En
septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun
dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur
départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors
aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe. pour barrer la route de passage du Galibier, et
faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les
travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du
fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en
1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,
afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les
allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui
leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En
septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun
dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur
départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors
aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe.
Des
conflits étaient aussi présents avec les habitants de la commune voisine de
Valmeinier. Les 2 villages se faisaient de nombreux "coup bas". Il existe
beaucoup d'anecdotes sur ces affrontements, notamment l'histoire que les
Valloirins auraient, une nuit, décroché les cloches de l'église de Valmeinier.
Heureusement, ces affrontements s'atténuèrent avec l'arrivée du tourisme
hivernal...
Haut de page
Ý
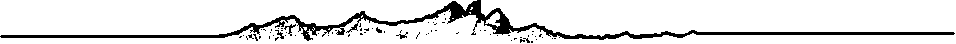
3.
Les prémices du tourisme
Comme
nous l'avons dit précédemment, Valloire est depuis toujours un lieu de passage.
Et c'est cette situation particulière qui lui apporta le tourisme, en premier
lieu
estival. En effet, de nombreux marchands s'arrêtaient à Valloire, et notamment
des anglais, pour gravir les nombreux sommets qui entourent la station, comme
les Aiguilles d'Arves. Valloire comportait déjà un hôtel pour accueillir les gens
de passage avant le 20e siècle, celui du Commerce. La légende dit que l'on
trouvait de l'or à Valloire, mais il s'agissait certainement plus de cristaux et
autres minerais.
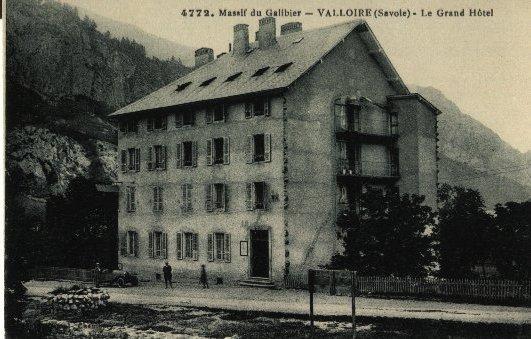 Mais
c'est
l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du
siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes
de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,
l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers
1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine
téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905
qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait
aucune remontée. Le tourisme de passage fut
renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire
n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de
Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années
1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y
avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà
comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie. Mais
c'est
l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du
siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes
de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,
l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers
1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine
téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905
qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait
aucune remontée. Le tourisme de passage fut
renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire
n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de
Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années
1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y
avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà
comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie. |
Haut de page
Ý
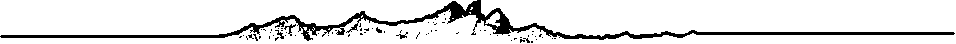
|
4.
Le temps de l'or blanc a/ Un succès
rapide mais difficile
La
station est lancée de 1934 à 1939 par le Club Alpin Français (CAF) qui créa
aussi Val d'Isère en Tarentaise. La commune de Valloire avait été retenue car
elle était proche d'une grande ligne de chemin de fer. Le train s'arrêta ainsi à
la gare de St Michel-Valloire dès 1934. Cet arrêt remporte un franc succès, et
pour répondre à l'afflux des
 voyageurs,
les arrêts se multiplient et un service d'autocars entre St Michel de Maurienne
et Valloire est installé. Pour faire de la promotion, on crée le syndicat
d'initiative en 1935. Les tentatives pour créer une véritable station de ski se
multiplient, et les
premières remontées apparaissent enfin: Gabriel Julliard, pionnier de la
station, installe en 1936 un téléski à l'Epinette, au hameau des Granges; il
reste aujourd'hui un pylône (photo ci contre). En 1937, il construit le téléski du
Grand Hôtel, parallèle à l'actuel télécabine du Crêt de la brive. voyageurs,
les arrêts se multiplient et un service d'autocars entre St Michel de Maurienne
et Valloire est installé. Pour faire de la promotion, on crée le syndicat
d'initiative en 1935. Les tentatives pour créer une véritable station de ski se
multiplient, et les
premières remontées apparaissent enfin: Gabriel Julliard, pionnier de la
station, installe en 1936 un téléski à l'Epinette, au hameau des Granges; il
reste aujourd'hui un pylône (photo ci contre). En 1937, il construit le téléski du
Grand Hôtel, parallèle à l'actuel télécabine du Crêt de la brive.
En
parallèle, la capacité d'accueil augmente : en 1936, on compte une
dizaine d'hôtel, des pensions et de nombreux meublés. Valloire hébergeait 1600 personnes
durant l'hiver
1936, et 2600 en 1937 !! Le succès est indiscutable. Valloire
devient le paradis des skieurs, car on y trouve neige et soleil (voir affiche
des années 50 ci 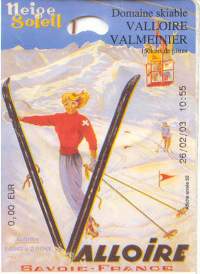 dessous).
Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente
Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de
l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station
de tourisme"
car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une
avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde
guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,
mais grâce à
l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre
en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.
GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet
est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène
publique. dessous).
Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente
Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de
l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station
de tourisme"
car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une
avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde
guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,
mais grâce à
l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre
en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.
GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet
est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène
publique.
Petite anecdote :
durant l'hiver 1945, il y eu une telle sécheresse que les remontées de Valloire
fonctionnaient au ralenti par manque de neige (pas de neige sur le premier
tronçon de la Sétaz!), et les skieurs montaient skier au
col du Galibier, où avait été installé par gravité une petite remontée. On installa aussi un fil neige à Plan Lachat. Comme quoi, le
manque de neige ne vient pas d'aujourd'hui !
|
|

|
Heureusement, Valloire bénéficie à cette époque des efforts incessants de
Gabriel Julliard. Après le téléski de l'Epinette, il construit le téléski de
St Pierre et le téléski des Plans en 1945. Puis, en 1948, il inaugure
le télébenne de la Sétaz (photo en dessous), et tant bien que mal il équipe
aussi le deuxième tronçon
de la Sétaz en 1951 par un autre télébenne, remplacé par la suite par un
télésiège 1 place. 1952 voit l'ouverture du nouveau domaine
skiable du
Crêt Rond avec un télébenne (photo ci contre), lui aussi remplacé par la
suite par un télésiège monoplace.
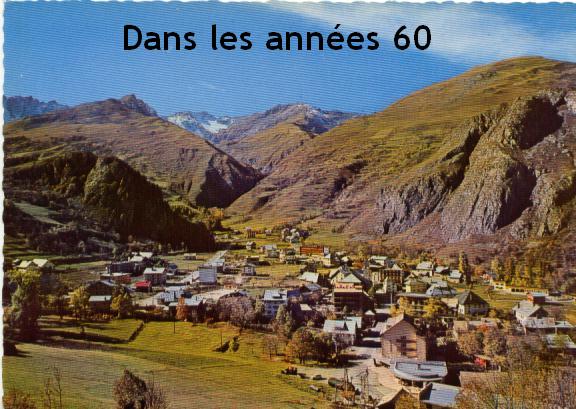 |
|
ñ
CLIQUEZ SUR L'IMAGE |
|
 |
 |
|
Le plateau de Thimel en 1969
ñ |
|

|
|
| ï
Premier télébenne de la station, surnommé "télébenne Julliard" du nom de son
créateur Gabriel Julliard |
|
Gabriel Julliard s'intéresse aussi le premier au Corbier, et
installe une cabine sur rail, le "cotérail" à Courchevel. En 1954, il avait comme projet
d'équiper le massif du Crey du Quart par un téléphérique. Mais il disparut
la même année lors de l'ouverture de la chasse. Sa mort resta cependant très mystérieuse,
et beaucoup songèrent à l'assassinat, car cet homme commençait à déranger
certains à cause de son poids économique qui pesait sur la vallée... C'est en 1957 que fut enfin portée
la commune au titre de station de tourisme. On compte alors 3500 lits à
Valloire. A cette
époque, le tourisme estival jouait un rôle primordial à Valloire, et
était beaucoup plus développé qu'aujourd'hui : Dans l'hôtel des Mélèzes, on
a relevé 40 visiteurs dans l'été 1959, contre 2 dans l'été 2000, à la même
période !! Vers la fin des années 50, la grande avenue de la vallée
d'Or est créée, ce qui marque le rassemblement des hameaux de Place sur l'actuel Valloire centre,
avant dispersés et séparés par des prairies et des marécages (regardez sur la
photo du télébenne du Crêt rond ci dessus en arrière plan) |
|
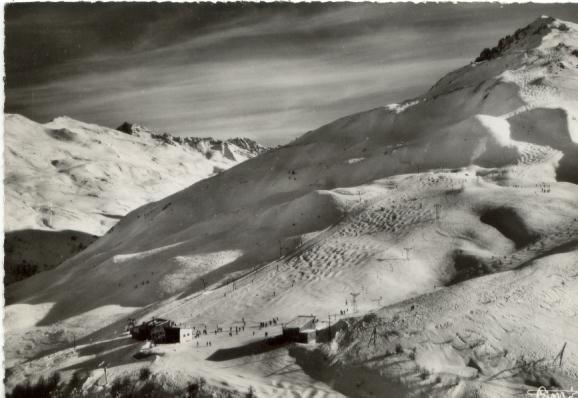
|
|
Le plateau de Thimel
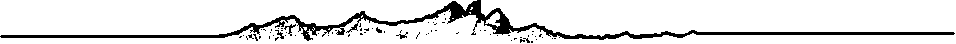
|
|


b/ Une expansion importante dès les années 1960
Valloire devient une grande station à partir des années 1960, et est même la
plus grande de Maurienne. Durant cette décennie, on peut noter la création
du cinéma (1962), du centre de secours (1974), de la salle polyvalente (1981),
de la patinoire artificielle (1984)... Le domaine skiable s'agrandit lui aussi
en parallèle:
●
Dans les années 60, le télébenne du 1er tronçon de la Sétaz est doublé par
le télésiège 2 places de Thimel (photo ci-contre). Sur la photo ci-dessous, on
voit bien ces deux remontées parallèles. Le domaine skiable s'étend ensuite vers
l'ouest avec le TK des
Diseurs (qui
partait légèrement en dessus de l'actuel TK de Cornafond) et du TK Sétaz des
prés (3e tronçon). Le point culminant de la station est ainsi de 2400m.
|
|

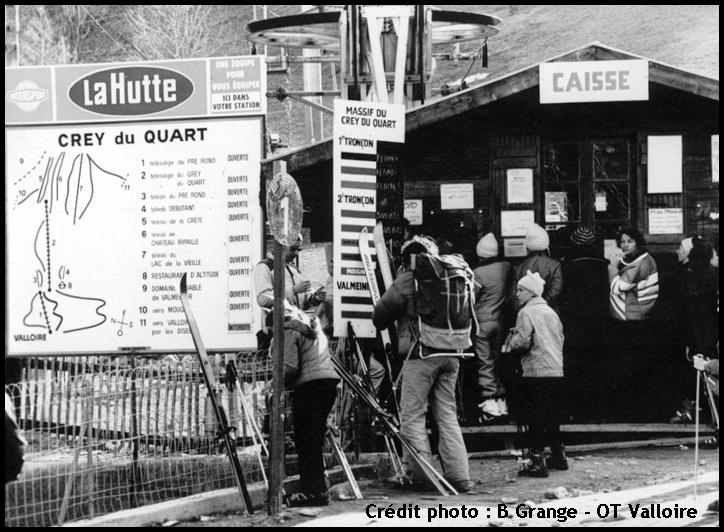 ●
Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places
et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du
Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK
des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes
étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis
le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la
commune de Valmeinier en 1974, qui comporte
alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK
Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc
effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi
le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis
l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS
Gros Crey). ●
Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places
et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du
Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK
des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes
étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis
le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la
commune de Valmeinier en 1974, qui comporte
alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK
Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc
effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi
le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis
l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS
Gros Crey).
|
|
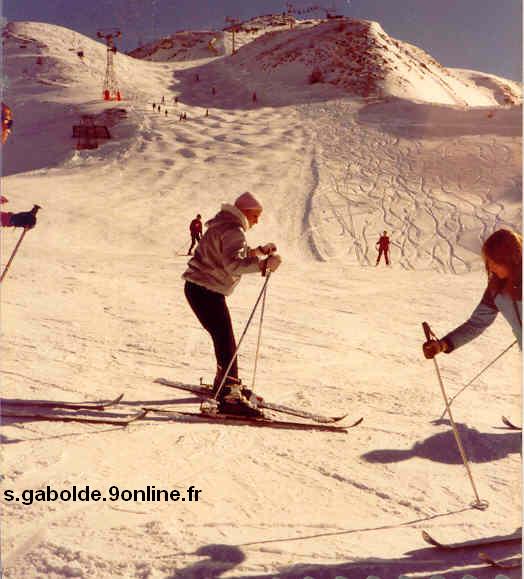 |
Il existe à cet époque 2 domaines bien distincts l'un de
l'autre : le domaine de la Sétaz, privé, géré par les Chamoux, et
celui du Crey du Quart, communal. Les forfaits étaient différents (Le Crey du
Quart était meilleur marché), ce qui fut un
"frein" pour la station, lui empêchant tout gros développement au
niveau du domaine skiable. Cette situation perdurera jusqu'à ce que la commune
installe le TK de Cornafond sur le domaine privé de la Sétaz en 1978, permettant ainsi de remonter
sur la Sétaz (le privé) depuis le Crey du Quart (le public). Peu de temps après, la totalité du domaine
fut gérée par la commune, ce qui permit un nouvel essor de la station...
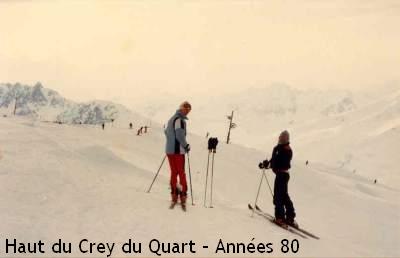 |
|
ñ
Plateau de Thimel dans les années 80 |
|

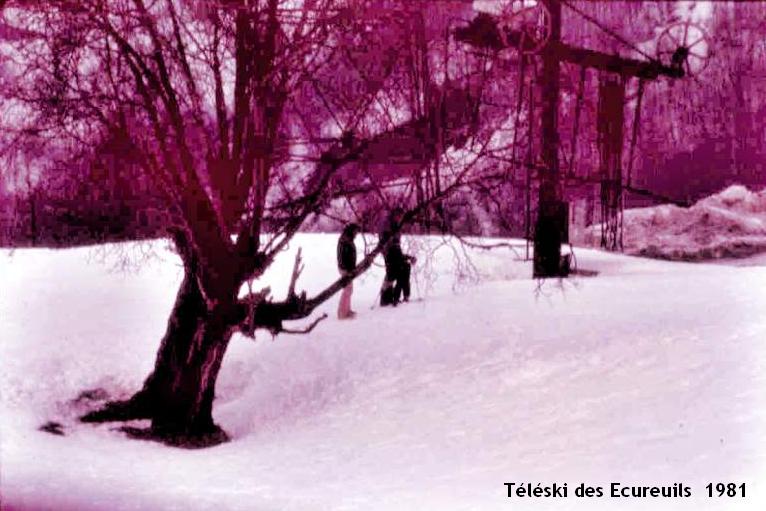 |
●
Dans les années 80, la réunion des deux domaines de Valloire permit un
forfait commun et de nombreux aménagements furent ainsi créés: TS de Montissot,
TS de Colérieux et TS des Verneys. Il était ainsi possible
de skier de l'Arméra aux Verneys "ski aux pieds". En 1987, Valmeinier agrandit
son domaine skiable sur le massif du Gros Crey avec 3 télésièges dont un
débrayable et un télépulsé assurant la liaison entre les 2 versants. La station
d'altitude de Valmeinier 1800 est créée plus en amont la même année, rapprochée
un maximum de Valfréjus. C'est en effet l'époque des grands projets, et la Croix
du Sud (projet de liaison des stations de Maurienne et d'Italie, lancé par le
promoteur Schnebelen) est en
discussion (ðVoir
dossier Croix du Sud). Grâce à l'équipement du
massif du Gros Crey, le domaine
skiable est doublé et atteint les 135 km de pistes, Valloire est comptée
désormais parmi les grandes stations, et est même la plus importante de
Maurienne. Cependant, Valloire reste discrète et ne participe pas
au tourisme de masse qui accable les voisines de Tarentaise. Le village évolue
peu, les constructions restent modérées et rien ne se construit. Valloire reste un petit paradis
fréquenté par les habitués du coin, peu médiatisé et échappant aux principaux
flux touristiques.
|
|

|
La
station, même si elle a su rester de taille modérée, n'a pas échappée à l'essor
du tourisme estival à la fin de la seconde guerre mondiale, et surtout dans les
années 70. Comme les autres stations,
les projets se sont multipliés et les constructions nouvelles ont fleuri dans la
montagne encore vierge... Mais les difficultés rencontrées ont
permis de préserver la station. Mais le temps de la conquête des grands
espaces a succédé à une période de réflexion et de restructuration... |
 |
|
CI CONTRE : Logo du
projet fou de la Croix du Sud |
Haut de page
Ý
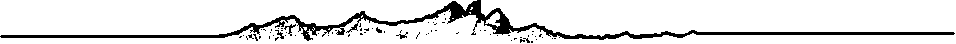
5. Une restructuration
complète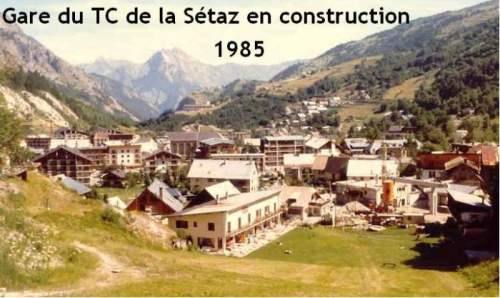
Depuis
la fin des années 1980, Valloire s'est concentrée sur l'amélioration des
équipements existants plutôt que sur les constructions nouvelles. On peut par
exemple citer le télécabine de la Sétaz en 1985, qui remplace le vieux télésiège
du premier tronçon, suivi du télésiège 4 places de Thimel qui remplace les
nombreux téléskis sur le plateau. Grace à ces deux nouveaux équipements,
Valloire pourra accueillir les courses de descente (accès facile, rapide et sûr). Sur le Crey
du Quart, on peut noter le remplacement du TK du lac de la vieille par un télésiège 4
places du même nom. Ce long téléski est d'ailleurs déplacé pour créer une nouvelle
zone skiable, celle du grand plateau. Pour l'hiver 1999, Valloire installe un
télécabine 8 places sur le Crey du Quart, véritable révolution pour le massif,
accessible auparavant par 2 télésièges 2 places de 1970 d'une extrême lenteur.
Le succès ne se fait pas attendre, le Crey du Quart retrouve une nouvelle
dynamique et devient même le massif le plus fréquenté. De
son côté, Valmeinier s'arrange à améliorer sa liaison avec Valloire, avec
l'installation du TK des Combes vers 1990, la création de la piste de la Neuvache en 2000, permettant de rejoindre l'Armera depuis Valmeinier 1800, la
piste de la Combe Orsière et le télésiège débrayable des Inversins en 2001, permettant de
rejoindre directement Valmeinier 1800 depuis Valloire (le grand plateau). On
peut aussi noter le doublage du TK de Plan palais, le
remplacement du "lent" télépulsé par un nouveau télésiège, et même le
remplacement du TS des Grandes Drozes par un télésiège débrayable 6 places pour
2005 ! Et ce
n'est pas tout, la commune a de nombreux projets ambitieux derrière la tête...
On voit de part ces investissements que Valmeinier a elle aussi repris un nouvel
essor (la faillite était proche dans les années 1990, et a obligé la commune à
se privatiser).
On ne
compte plus aucun agrandissement sur le domaine skiable de Valloire depuis les années 1990. La station
s'est en effet concentrée sur l'installation de canons à neige, jugé prioritaire
vu le manque chronique de neige dans le bas du domaine skiable. La neige
artificielle envahit ainsi progressivement tout le 1er tronçon du massif de la
Sétaz, et le bas du domaine du Gros Crey, et depuis peu le Crey du Quart. Les
liaisons importantes sont ainsi confortées par 350 canons à neiges, permettant
du ski très correct de début décembre à fin avril. Un important projet est même
en train de voir le jour : c'est à terme plus de 700 canons à neiges qui
devraient être installés de part et d'autre du domaine, de 1430 à 2600m
d'altitude, sur le Crey du Quart comme sur la Sétaz. Le petit domaine du Crêt Rond
a quant à lui fermé ses portes dans les années 2000, par manque de neige et de
fréquentation (trop excentré et trop vieux). Ce
petit télésiège avait cependant réouvert quelques années, uniquement pour
desservir des champs de hors pistes (il n'y avait plus de pistes balisées).
Dans le village, de
nombreuses nouvelles
habitations sont construites sous forme de résidences de tourisme principalement
au Moulin Benjamin et aux Charbonnières (sur le flanc du Crey du Quart). Le but
de la
commune étant d'atteindre 18000 lits, afin de pouvoir renouveler le parc de remontées
mécaniques, et ainsi augmenter
le débit du domaine skiable face à l'affluence de cette nouvelle clientèle. Le
télésiège 4 places du lac de
la vieille par exemple a été remplacé en 2004 par un télésiège débrayable 6
places. Quant au Crêt Rond, un dossier UTN pour sa reconstruction et son
agrandissement a été accepté (ðVoir
dossier Crêt Rond). Bien que
bénéfiques économiquement parlant, les constructions immobilières sont de plus
en plus importantes, et poussent comme des champignons de part et d'autre de la
station. Si le paysage reste toujours aussi magique aujourd'hui, attention de ne
pas tout gâcher avec cette concentration massive de résidences... Mais c'est
difficile de résister à son succès : les efforts de tant d'années portent leurs
fruits, et Valloire, longtemps méconnue de beaucoup, est en train de se hisser
dans la "tête de peloton". La croissance est impressionnante (+20% l'année
dernière!) et les vacanciers toujours aussi comblés par la beauté du site,
et promettant de revenir l'année suivante !
|
Le village de Valloire
aujourd'hui |
Le succès est présent aussi de l'autre coté du Crey du Quart, comme le témoigne
l'extension de la station. 15 ans après le début des travaux de Valmeinier 1800,
la station affiche complet au niveau des constructions, et un 3e pôle commence à
apparaître, sur la route entre 1500 et 1800 au lieu-dit la Sausette. Les grandes
enseignes qui avaient longtemps abandonné la vallée refont surface et les
vacanciers reviennent...
 Le
bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression
d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il
semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme
avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous
âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,
car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de
Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de
Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du
tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les
stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à
Valloire recherche autre
chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la
chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le
séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui
pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts
dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si
durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas
survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est
malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans
ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se
termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui
continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps... Le
bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression
d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il
semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme
avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous
âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,
car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de
Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de
Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du
tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les
stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à
Valloire recherche autre
chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la
chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le
séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui
pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts
dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si
durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas
survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est
malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans
ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se
termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui
continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps...
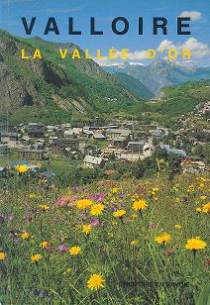
S.GABOLDE
Sources :
-
"Valloire, la vallée d'or" , L'HISTOIRE EN SAVOIE NUMERO SPECIAL ETE 1989
(ci-contre)
- Les souvenirs de mon
père, de mon grand père, et de valloirins
Haut de page
Ý |
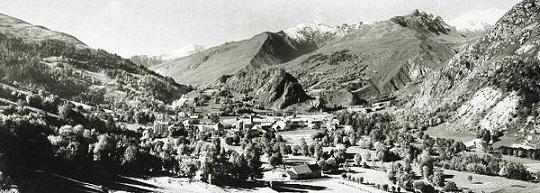
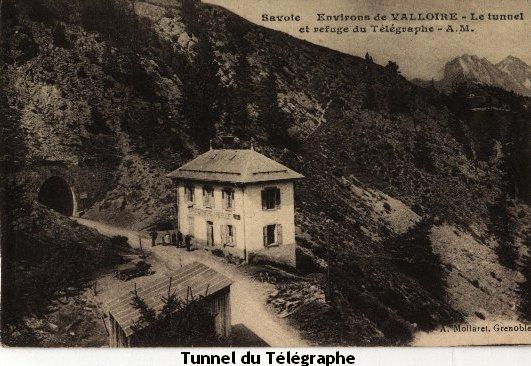
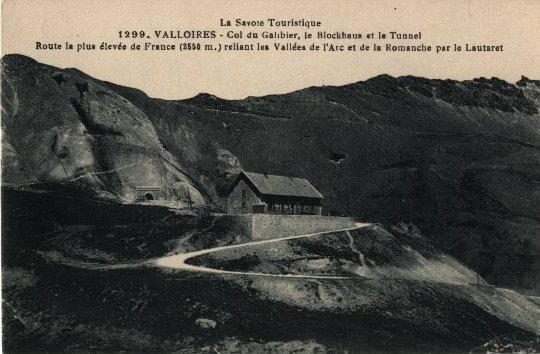 pour barrer la route de passage du Galibier, et
faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les
travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du
fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en
1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,
afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les
allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui
leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En
septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun
dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur
départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors
aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe.
pour barrer la route de passage du Galibier, et
faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les
travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du
fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en
1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,
afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les
allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui
leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En
septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun
dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur
départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors
aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe.
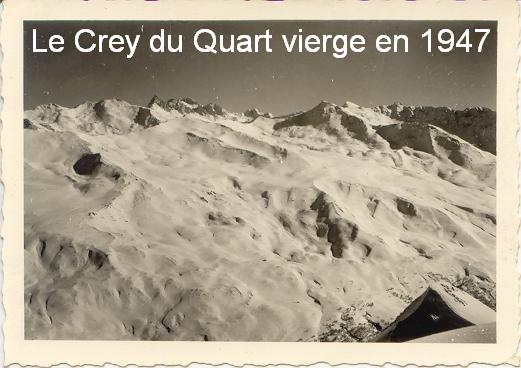
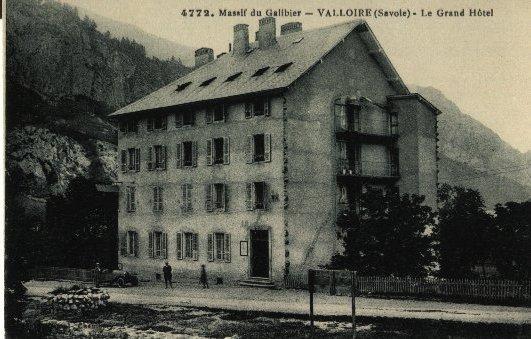 Mais
c'est
l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du
siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes
de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,
l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers
1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine
téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905
qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait
aucune remontée. Le tourisme de passage fut
renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire
n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de
Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années
1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y
avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà
comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie.
Mais
c'est
l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du
siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes
de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,
l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers
1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine
téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905
qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait
aucune remontée. Le tourisme de passage fut
renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire
n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de
Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années
1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y
avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà
comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie.
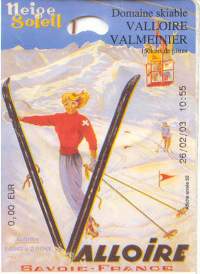 dessous).
Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente
Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de
l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station
de tourisme"
car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une
avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde
guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,
mais grâce à
l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre
en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.
GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet
est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène
publique.
dessous).
Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente
Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de
l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station
de tourisme"
car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une
avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde
guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,
mais grâce à
l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre
en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.
GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet
est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène
publique.
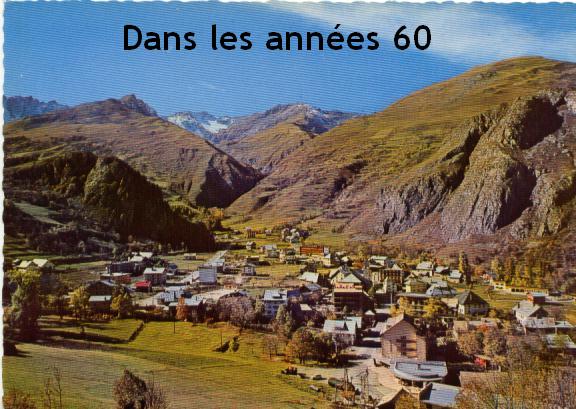



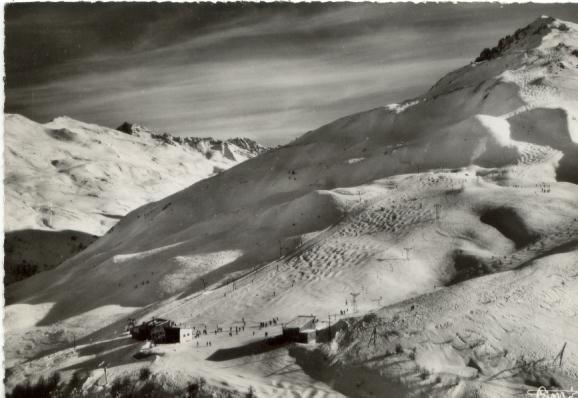



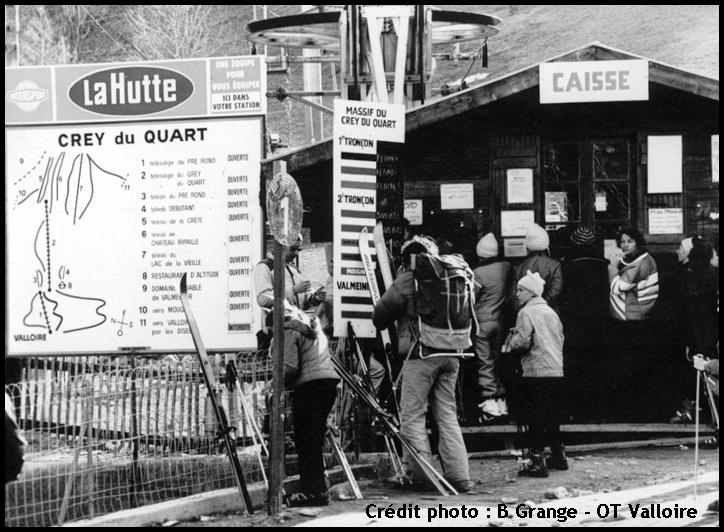 ●
Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places
et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du
Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK
des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes
étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis
le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la
commune de Valmeinier en 1974, qui comporte
alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK
Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc
effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi
le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis
l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS
Gros Crey).
●
Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places
et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du
Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK
des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes
étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis
le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la
commune de Valmeinier en 1974, qui comporte
alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK
Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc
effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi
le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis
l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS
Gros Crey).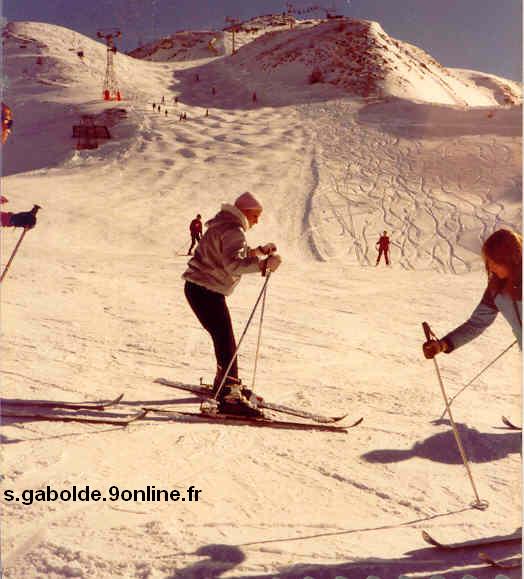
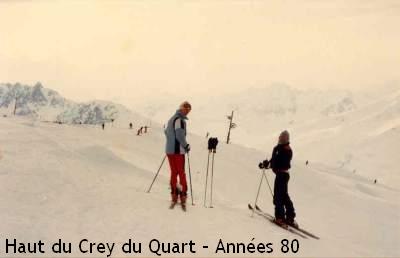

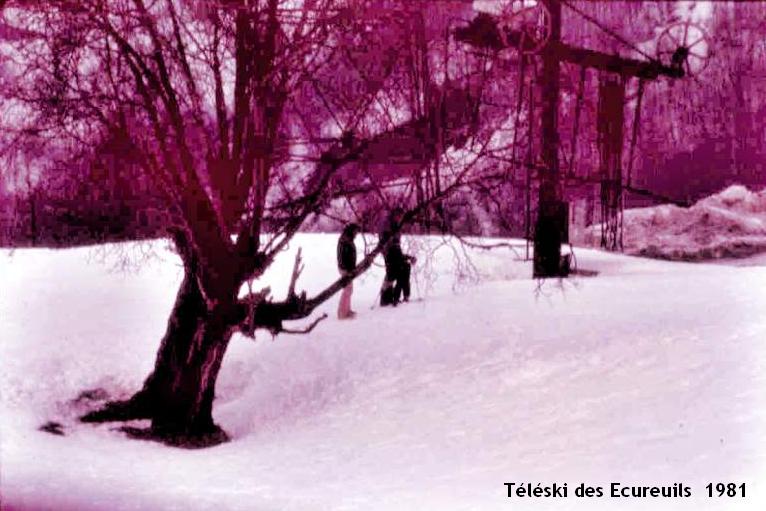


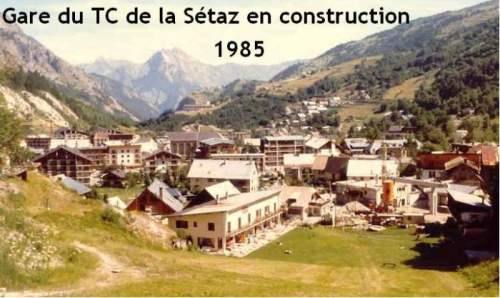
 Le
bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression
d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il
semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme
avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous
âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,
car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de
Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de
Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du
tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les
stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à
Valloire recherche autre
chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la
chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le
séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui
pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts
dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si
durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas
survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est
malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans
ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se
termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui
continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps...
Le
bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression
d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il
semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme
avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous
âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,
car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de
Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de
Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du
tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les
stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à
Valloire recherche autre
chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la
chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le
séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui
pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts
dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si
durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas
survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est
malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans
ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se
termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui
continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps...